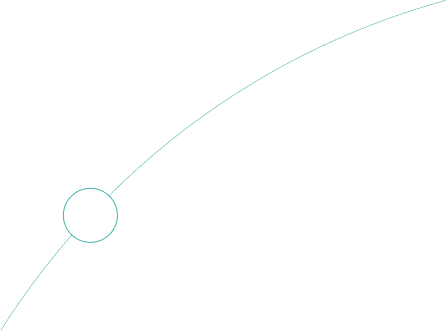Libérer l’entreprise, dans quel but ?
Gagner en agilité, c’est aujourd’hui gagner en performance, la cause est entendue. Nombre de start-ups, innovantes par essence, ont attiré l’attention des médias par un mode de management aplani, des circuits de contrôle courts et une grande autonomie laissée aux collaborateurs. Se débarrasser des échelons intermédiaires du management créerait de la performance et du bonheur au travail ; l’opération paraît bonne pour l’entreprise sur le plan économique et, un peu cyniquement, sur celui de l’image employeur et institutionnelle véhiculée.
Qu’en est-il côté collaborateurs ? Les processus verticaux, caractéristiques de l’industrie taylorienne où l’autonomie est réduite à sa plus simple expression, sont l’une des principales sources de souffrance au travail car ils empêchent de se sentir responsable. L’estime de soi pâtit du manque de confiance accordé par une hiérarchie qui, en contrôle permanent, décourage l’initiative. Sans aller jusqu’à l’holacratie pure et dure, l’entreprise libérée peut donc être un moteur fort d’engagement des salariés dans le travail : plus encore, elle semble être la clé pour que chaque collaborateur se sente non seulement utile, mais fier de ce qu’il accomplit. Il joue un rôle et se réalise.
Libérer l’entreprise, comment ?
Le taylorisme, qui influence encore profondément l’organisation de la plupart des grands groupes industriels, a permis que n’importe quel ouvrier puisse occuper un poste après une brève formation. Or, si l’existence de processus bien cadrés peut rendre rapidement opérationnels des salariés modérément compétents et engagés, ces derniers sont peu adaptables. C’est tout le problème des organisations d’aujourd’hui qui ont besoin d’acteurs souples et investis, à même de gérer un changement ou une complexité non prévus. Il convient donc de susciter l’engagement en misant sur le facteur humain, c’est-à-dire en accordant la confiance nécessaire à l’autonomie et à la responsabilisation.
Plus qu’un changement de mentalité, ceci suppose un nouveau regard sur le capital humain : considérer le collaborateur comme compétent, c’est-à-dire fiable, et comme loyal, donc investi dans son travail pour la réussite de l’entreprise. Considéré comme le meilleur expert de son activité, chaque collaborateur est, à ce titre, légitime pour piloter celle-ci comme il l’entend. Premier effet sur l’organisation, la disparition des longues boucles de contrôle, qui représentent un coût très important dans les grands groupes. Pour être effective, l’autonomie doit se vérifier sur :
• la détermination du projet d’action qui servira le mieux la stratégie et les objectifs de la Direction,
• l’organisation, les processus et méthodes pour réaliser le projet d’action,
• le contrôle, les collaborateurs et équipes étant garant de la qualité et de la pertinence de leur travail.
C’est là que des murmures de protestation s’élèvent, notamment dans les grands groupes. Les premiers à tousser sont évidemment les managers.
L’entreprise libérée sonne-t-elle le glas du management ?
Les outils connectés, le nomadisme, des SIRH de plus en plus performants ont, ces dernières années, beaucoup rudoyé le management « à l’ancienne ». L’entreprise libérée va-t-elle lui porter le coup de grâce ?
L’un des rôles majeurs du management traditionnel était d’être un canal de transmission de l’information, qu’elle soit ascendante ou descendante : informer le dirigeant sur ce qui se déroule dans l’entreprise, transmettre les décisions de celui-ci aux équipes et les mettre en application. Le modèle de l’entreprise libérée supposant que les collaborateurs sont légitimes, individuellement ou collectivement, pour prendre les décisions, ce management-là n’a plus lieu d’être. Obsolètes, les tâches administratives et de contrôle le sont aussi, qui représentent dans le modèle traditionnel une bonne moitié de l’activité du management intermédiaire. À en croire les entreprises s’étant « libérées », déléguer les décisions aux opérationnels permettrait de passer de 7 à 2 niveaux hiérarchiques. Au-delà du meilleur engagement du capital humain et de son bien-être, le ROI est évident.
Reste qu’il faut un leader, à tout le moins un responsable, pour coordonner les actions et fluidifier la coopération. Celui-ci va s’employer à aider salariés et équipes en écartant les obstacles se trouvant sur le chemin qu’ils ont choisi. À eux de choisir s’il faut investir, recruter, changer de processus. À lui de favoriser les bonnes décisions par sa réflexion et en offrant une vision claire des objectifs et de la stratégie de l’entreprise. Le management ne disparaît donc pas totalement dans le modèle de l’entreprise libérée, mais il n’est plus qu’au service des collaborateurs, qui sont eux-mêmes au service des clients. Une mue qui a déjà touché la fonction RH, et que l’entreprise libérée accélèrerait encore. Quid, en effet, du rôle d’un DRH ne pilotant plus les recrutements ?
Peut-on libérer l’entreprise » à moitié «
Une communauté de travail dont l’autonomie serait la pierre angulaire suppose, on l’a vu, une adhésion pleine et entière à une valeur maîtresse, la confiance. Or celle-ci ne peut exister sans le respect de valeurs satellites comme la loyauté, le sens des responsabilités, sans compter le rôle de l’écoute et du dialogue puisqu’il ne s’agit plus d’ordonner lors d’une prise de décision, mais de convaincre. Si la communication de recrutement s’est, dans le passé, souvent permis de brandir des valeurs dans le seul but de séduire les meilleurs candidats, l’entreprise libérée ne peut se permettre ce type de dérapage. Sa réussite repose en effet largement sur le respect effectif de valeurs, qui ne sauraient être des postures.
En résumé, l’entreprise libérée ne peut s’appréhender comme un artifice destiné à dynamiser une image employeur poussive. Elle constitue un vrai saut vers une autre forme de travail et d’entreprise. Le prix à payer, pour un gain certainement appréciable en termes d’agilité et de satisfaction d’une majorité de salariés, est l’abandon d’une vision pyramidale de l’entreprise tenace en France. Le culte des diplômés des grandes écoles, attachés aux organisations verticales, constitue lui aussi un frein à la bascule.
De plus en plus d’entreprises ont conscience que les méthodes et le management d’hier ne permettent pas de relever les défis d’aujourd’hui. Mais l’entreprise libérée propose-t-elle un vrai « renversement de pouvoir » générateur de bien-être ? Le débat s’enflamme depuis une tribune de François Gueuze qui, le premier, a dénoncé l’imposture que peut représenter l’entreprise libérée, en concentrant au contraire le contrôle et le pouvoir entre les mains d’un seul ou en créant un risque de surengagement. Auditer les salariés sur leurs aspirations réelles ne pourra qu’éclairer utilement la décision de franchir, ou non, le pas.